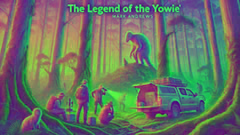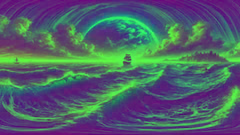Introduction
Sur les berges où le Zambèze porte ses années dans une lumière vitreuse, les habitants ont appris à écouter le fleuve comme s'il était un vieil aîné. Ils racontent des histoires dans le silence de l'aube, quand la brume colle encore aux baobabs et que les oiseaux entonnent leurs notes dans un chœur plus ancien que les tambours du village. Dans ces récits, Nyami Nyami — le grand serpent du fleuve — se meut avec la gravité des saisons, gardien dont les écailles captent le soleil et dont le souffle rend le courant doux ou le fait monter comme un battement de cœur. Pour les anciens, Nyami Nyami n'est pas seulement un dieu des crues et des sécheresses ; il est un témoin patient, un partenaire dans le travail quotidien : la pêche, l'agriculture et l'arithmétique obstinée et pleine d'espoir de nourrir une famille quand le fleuve change d'avis. On dit que Nyami Nyami a une épouse, Nyaminyami, dont la mémoire court comme un fil d'argent le long des rives d'argile rouge du fleuve. Ils partagent une vie aussi intime que le ciel nocturne et aussi vaste que l'eau elle-même, une mémoire qui devient une carte pour les voyageurs, un avertissement pour ceux qui tenteraient la patience du fleuve, une promesse pour les générations qui doivent apprendre à vivre avec la clémence et la fureur de l'eau. Lorsque le barrage de Kariba s'éleva de la terre avec le grondement d'une tempête qui fend une colline, le fleuve changea de voix. Des piles de béton perçaient le ciel, des vannes se réveillaient dans un fracas, et les vieux chants — ceux qui parlaient le langage du fleuve — commencèrent à ressembler à un alphabet étranger pour les gens qui stationnaient sur la rive, leurs paniers et leurs questions en main. Le barrage modifia non seulement le cours du fleuve mais aussi la forme de la mémoire. Nyami Nyami, gardien bien-aimé de la vallée, se trouva séparé de sa compagne par ce que les humains croyaient être la chose qui dompterait le fleuve : une barrière. Pourtant le courant n'oublia pas ; il apprit seulement de nouveaux courants, et les anciennes questions d'amour, de protection et d'appartenance ne disparurent pas au bord de l'eau. Ce récit suit un village qui refuse d'abandonner ses légendes, même lorsque le monde moderne — usines, routes et projets hydroélectriques — s'avance avec des silhouettes vives et tranchantes. Il s'interroge sur ce que signifie rester fidèle à son fleuve lorsque celui-ci présente une géométrie nouvelle et étrangère qu'il faut apprendre à naviguer. Il se demande comment une communauté peut s'accrocher au regard de Nyami Nyami lorsque l'ombre d'un barrage s'allonge un peu plus chaque année. Et il demande, insistant, si les dieux écoutent encore lorsque la terre tremble sous les travaux et que l'air sent le ciment et la promesse. La légende devient une conversation vivante, une sorte de liturgie murmurée au bord de l'eau, portée par le souffle des enfants qui mesurent la profondeur de l'eau à pieds nus, et par le battement des tambours des anciens qui maintiennent les vieux chants vivants dans un monde qui continue d'avancer. Dans cette longue et patiente écoute, Nyami Nyami apprend de nouveau à étirer son corps serpentin le long du méandre, à incliner sa tête vers le cœur de la vallée, à tendre l'oreille aux petits verbes du soin : la grand-mère qui sème le maïs sur la berge, le pêcheur qui règle ses filets selon les caprices du fleuve, la jeune danseuse qui tourne pour imiter les rides de l'eau. Et le peuple, à son tour, apprend à entendre une autre façon de dire — la manière dont le fleuve parle dans le bruissement des nattes de roseau, dans la façon dont son ombre tombe sur la porte ouverte d'un shebeen, dans le bourdonnement lointain du barrage qui devient une orchestration en couches leur rappelant la maison. La légende n'efface pas le barrage ; elle nous invite à voir le barrage comme un nouveau paysage dans lequel les anciennes loyautés doivent se frayer un chemin avec la même patience que Nyami Nyami a toujours montrée. C'est l'histoire de mains burinées et d'espoirs lumineux, d'un fleuve qui refuse d'être propriété ou d'être réduit au silence, d'un dieu qui demeure, au final, un gardien qui apprend même aux bâtisseurs à entendre la sagesse du monde vivant. Ainsi, tant que le Zambèze coulera et que la vallée retiendra son souffle, Nyami Nyami perdurera — vigilant, aimant et tenace.
Section I : La voix du fleuve
Le fleuve se souvient, même quand il semble oublier. Dans les longues journées qui précédèrent l'ouverture du barrage, comme l'aurore d'un nouveau siècle, Nyami Nyami se mouvait selon l'humeur du fleuve — à la manière d'un amant qui suit les pas de l'être aimé, prenant soin de ne pas effrayer son souffle. Les anciens disent que Nyami Nyami est né du premier soupir du fleuve, un grand serpent dont les écailles avaient la couleur de la pluie du matin et dont les yeux brillaient de la patience des montagnes. Il ne considérait pas le fleuve comme une frontière mais comme un corridor vivant d'histoires, un lieu où l'on apprenait à écouter avant de parler, à attendre la réponse même du fleuve avant de lancer une ligne ou d'allumer un feu. Les habitants de la vallée apprirent à honorer ce gardien vigilant par des offrandes de bière de maïs, des chants brodés du nom du fleuve et des prières murmurées entre les claquements de mains lors des danses du soir. Nyaminyami, sa femme, apparaît dans la mémoire de l'eau comme compagne et contrepoids — tendre, farouche et sans peur de la profondeur du fleuve. Quand le temps s'alourdissait et que les tambours montaient en intensité, Nyami Nyami enroulait sa grande forme autour du méandre, et le fleuve écoutait, son courant s'alignant sur son souffle. Ils formaient un couple d'un monde qui comprenait que la vie et l'eau ne sont pas des possessions mais des accords : on respecte le fleuve, et le fleuve nous respecte en retour. La vallée parlait un langage de rythmes — le battement de la kalimba, la cadence du chant du pêcheur, l'arithmétique silencieuse des semailles avant les tempêtes. Les enfants apprenaient à prononcer le nom de Nyami Nyami doucement, comme s'il pouvait s'échapper de la bouche s'il était trop fort et réveiller les vieux dieux. Puis, d'un souffle qui ressemblait à une aube qui se fissure, le barrage jaillit de la terre, une ligne nette et brillante qui scinda le long et patient récit du fleuve en un avant et un après. Les charpentiers et ingénieurs qui construisirent le barrage de Kariba nourrissaient leur propre croyance : qu'ils pouvaient mesurer le temps, qu'ils pouvaient plier la nature à un calendrier. Ils n'écoutaient pas toujours le fleuve qu'ils cherchaient à dompter, et la voix du fleuve s'est d'abord faite plus discrète, puis elle commença à parler en brusques montées et en pauses qui ressemblaient à un battement de cœur sous la pierre. Certaines nuits, quand les turbines se mirent à bourdonner et que la vallée refroidissait après la chaleur du jour, l'eau tremblait d'une manière que les villageois pouvaient sentir jusque dans leurs os. C'était comme si Nyami Nyami et Nyaminyami tournaient autour de la nouvelle barrière, nommant l'espace dans lequel le fleuve devait apprendre une nouvelle langue. Au fil de ces années, les gens apprirent à raconter les histoires du fleuve à voix haute, non comme une superstition mais comme une carte : garde les chants en bouche, répare les filets, tiens les enfants près de la rive pendant que le fleuve parle. Le conte de Nyami Nyami est, au fond, un rappel que la tutelle n'est pas un bouclier contre la perte mais un serment de durer, de porter une lignée de mémoire même lorsque le sol bouge et que le cours de l'eau devient un fil qu'il faut suivre sur un métier différent. La section se clôt sur une écoute attentive : le fleuve parle, et les gens choisissent d'entendre ; Nyami Nyami garde sa veille au méandre, où les vieux chants gisent comme des pierres attendant d'être foulées par des pieds qui croient encore en la clémence du fleuve.

Section II : Le barrage et la distance silencieuse
Le barrage s'éleva comme une ville taillée dans la pierre, un monument à l'ambition humaine qui croyait pouvoir réécrire le climat et le temps avec du béton et de l'acier. Pour la vallée, Kariba devint une porte vers le pouvoir et la possibilité — une source d'électricité qui éclairerait écoles et marchés et apporterait le progrès à une région qui avait appris à vivre avec la pénurie. Pour Nyami Nyami, le barrage représentait une nouvelle sorte de fleuve, une barrière qui ne mettait pas fin à la vie du cours d'eau mais modifiait sa respiration. Le grand serpent observa la terre s'élever sous le lit du fleuve, tandis que le bruit des burins et des moteurs remplaçait les anciens murmures du fleuve par un chœur métallique. Nyaminyami ne disparut pas ; elle se fit plus discrète, son visage n'apparaissant désormais que dans les rides de l'eau, une mémoire qui s'accrochait à la surface comme la rosée. Les villageois, quant à eux, se retrouvèrent divisés par une nouvelle géographie. Certains croyaient que le gardien du fleuve s'adapterait, que les anciennes lois pourraient se courber suffisamment pour permettre à Nyami Nyami de parcourir les nouveaux rythmes du fleuve. D'autres craignaient que la séparation ne scelle une fracture entre amants et proches, que le fleuve n'oublie les noms des personnes qui vivaient à ses côtés depuis des générations. Pourtant le fleuve n'oublia pas. Lors des tempêtes, quand le vent déchirait l'ombre du barrage et que l'eau montait en un arc soudain et furieux, les gens ressentaient une secousse familière dans leur poitrine. Nyami Nyami se déplaçait le long du bord du barrage dans leurs rêves, une forme lointaine qui miroitait sous la pluie et renvoyait la lumière des turbines comme mille petits miroirs. Les vieux récits commencèrent à donner naissance à de nouveaux rituels : des chants adressés aux tours, des offrandes lancées vers le fleuve depuis de petites embarcations qui dérivaient sous la sombre façade du barrage, des prières murmurées dans les interstices entre les machines et les montagnes. Dans les années qui suivirent, un courage discret s'installa dans la vallée — une compréhension que la tutelle n'est pas toujours portée par un geste unique et dramatique mais par une fidélité patiente et obstinée. Nyami Nyami apprit à habiter l'espace entre l'ancienne courbe du fleuve et la charnière de fer du barrage, à étirer sa présence à travers la largeur des canaux et des ravins alimentés par l'eau d'un fleuve moderne et agité. Les gens apprirent à mesurer le progrès non pas à la hauteur d'un barrage mais à la profondeur de leur mémoire : les chants préservés, les filets raccommodés et les histoires partagées lors des longues soirées lentes où les lampes vacillaient dans de petites huttes et où le fleuve faisait entendre son appel ancien dans la voix du vent. Les tempêtes et les sécheresses allaient et venaient, mais la foi de la vallée persistait : Nyami Nyami restait, un gardien qui ne livrerait pas sa famille ni son peuple aux nouvelles machines ; au contraire, il leur offrait une manière d'écouter plus profondément, de s'accrocher à l'essentiel lorsque le monde demande de nouvelles réponses. La conclusion, comme un souffle retenu au cœur d'un fleuve, n'arrive pas triomphalement mais sous la forme d'une promesse : nous nous souviendrons, nous raconterons les histoires qui maintiennent le cœur du fleuve en vie, et nous apprendrons à vivre avec la nouvelle langue du fleuve jusqu'à ce que les vieux chants reviennent et que le regard du gardien se repose à nouveau sur la vallée avec la même miséricorde patiente et durable.

Conclusion
Si le fleuve pouvait parler d'une centaine de voix, il reviendrait toujours au seul mot qui les lie tous : perdurer. La légende, inscrite dans les voix des anciens et répétée par le courant du fleuve, reste une constitution vivante de la vallée. Elle enseigne que le pouvoir et le progrès doivent cheminer avec humilité, que la tutelle survit non par la domination mais par l'écoute, et que l'histoire d'une communauté n'est pas tant un musée qu'un partenaire vivant et respirant dans les actes quotidiens de soin. Le barrage de Kariba se dresse, oui — emblème de l'accomplissement moderne — mais son ombre porte aussi la responsabilité de se souvenir que chaque vanne ouverte, chaque turbine mise en marche, modifie une ligne dans la longue chanson du fleuve. Ainsi les gens racontent-ils sans cesse à leurs enfants l'histoire de Nyami Nyami : non comme un mythe uniquement, mais comme une leçon d'émerveillement et de responsabilité. Ils apprennent aux jeunes à garder les berges dégagées et à parler doucement à l'eau, à laisser de petites offrandes de respect et de gratitude pour les gardiens qui protègent non seulement la richesse du fleuve mais aussi l'âme de la vallée. Et lorsque les pluies arrivent et que le fleuve gonfle, ils écoutent non seulement avec crainte mais avec reconnaissance : le fleuve n'est pas conquis, on lui demande de partager sa sagesse. Le regard de Nyami Nyami parcourt le méandre, et dans ce regard se trouve une révolution discrète : la promesse que le passé sera honoré, que le présent sera affronté avec courage, et que l'avenir — quoi qu'il réserve — sera navigué ensemble, comme un seul peuple, un seul fleuve, une seule histoire.